Comment planifier votre succession ?
Le droit successoral n’est pas si simple. N’hésitez donc pas à vous faire conseiller par une étude notariale.
Par ailleurs, il existe différents instruments de planification successorale :
- Le contrat de mariage
- Rédiger un testament
- Souscrire un contrat d’assurance-vie
- Faire une donation
- Le pacte successoral
- Le mandat de protection extrajudiciaire
Vous trouverez plus d’informations dans l’infofiche de Notaire.be sur les différents actes que le notaire peut rédiger pour vous.
Bon à savoir
Sur le site notaire.be vous pouvez retrouver une fiche informative concernant les actes permettant de faire de la planification successorale.
Faites-vous conseiller
Si vous n’êtes pas familier avec tout ce qu’implique une succession, il est préférable de demander un conseil, même dans les situations simples : cela ne coûte pas grand-chose et cela peut vous épargner bien des soucis, ainsi qu’à vos héritiers…
Un notaire mais aussi un conseiller bancaire, un gestionnaire de patrimoine ou un avocat peuvent vous donner des conseils. Sachez que vous ne devez en principe pas payer la première consultation chez un notaire. Ce dernier pourra non seulement vous conseiller mais aussi poser des actes en tenant compte de vos souhaits.
Il est particulièrement recommandé de demander conseil si :
- Vous avez un patrimoine important.
- Votre situation familiale est plus « complexe » (vous avez par exemple une famille recomposée).
- Vous êtes propriétaire ou actionnaire d’une entreprise familiale.
- Vous possédez des biens à l’étranger.
- L’un de vos enfants est handicapé.
- Vous avez de moins bonnes relations avec l’un de vos héritiers.
- Vous avez peu de proches.
- Vous souhaitez léguer ou donner à une association caritative.
- Etc.
Dans chacune de ces circonstances, il peut être utile de prendre des mesures spécifiques.
Le mariage et le type de contrat de mariage
Le mariage exerce une grande influence sur ce qu’il advient de votre héritage !
Si vous ne signez pas de contrat de mariage, c’est le régime légal qui s’applique.
Un couple marié qui n’a pas signé de contrat de mariage possède trois patrimoines : le patrimoine propre de chacun des deux conjoints et leur patrimoine commun.
Si l’un des conjoints décède, les règles de la succession légale s’appliquent.
Dans le cadre d’une succession avec enfants
- Le conjoint survivant reste naturellement propriétaire de son propre patrimoine.
- Lorsque le patrimoine commun est partagé, le conjoint survivant reçoit naturellement sa moitié de la communauté.
- Le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit de l’autre moitié du patrimoine commun et de l’usufruit du patrimoine propre au conjoint défunt.
- Les enfants héritent quant à eux de la nue-propriété de l’autre moitié du patrimoine commun et de la nue-propriété du patrimoine propre du défunt.
Dans le cadre d’une succession sans enfants
- Le conjoint survivant hérite de la totalité des biens communs et de l’usufruit des biens propres du défunt.
- La famille du défunt hérite quant à elle de la nue-propriété des biens propres du défunt.
Si les conjoints optent pour un contrat de mariage, ils peuvent utiliser certaines clauses qui protègent le partenaire survivant. Certains couples choisissent de léguer, dans un contrat de mariage, la totalité du patrimoine commun en pleine propriété au conjoint survivant lorsque l’autre décède. Ils reprennent pour ce faire dans leur contrat de mariage la clause : « au dernier vivant tous les biens ». Mais cette clause présente aussi un désavantage : à terme, elle entraîne souvent des droits de succession plus élevés pour les enfants lorsqu’intervient le décès du deuxième parent.
De plus, le conjoint survivant hérite aujourd'hui de toute façon de la maison familiale en usufruit, de sorte que ces clauses ne sont pas toujours très utiles.
C'est pourquoi de telles clauses « au dernier vivant, les biens » sont remplacées par des clauses de choix facultatif. Ces clauses sont fiscalement plus intéressantes, car elles donnent plus de liberté au partenaire survivant. Elle ou il peut choisir exactement ce dont elle ou il hérite en pleine propriété. Il est donc conseillé aux personnes ayant un ancien contrat de mariage de le faire réviser chez le notaire.
Depuis la réforme intervenue au 1er septembre 2018, le régime de la séparation de biens protège davantage le conjoint économiquement le plus faible. La nouveauté réside dans la possibilité pour les futurs époux de s’accorder sur l’insertion ou non d’une clause de « correction en équité ». L’avantage d’une telle clause permet au conjoint lésé de solliciter auprès du tribunal, et sous certaines conditions, l’octroi d’une indemnité en cas de divorce. Plus d’info sur cette clause qui permet de renforcer une certaine solidarité entre époux.
Rédiger un testament
C’est la loi qui règle le partage de l’héritage : c’est la dévolution légale. Si vous souhaitez une autre répartition, vous pouvez rédiger un testament. Mais le conjoint survivant et vos enfants ont toujours droit à leur part réservataire.
Que pouvez-vous faire par le biais d’un testament ?
Vous pouvez avantager par exemple un ou plusieurs héritiers. Vous pouvez également limiter l’héritage d’un héritier ou donner une partie de votre héritage à une bonne cause. Dans la pratique, c’est souvent la technique du legs en duo qui est appliquée. Si vous êtes domicilié à Bruxelles ou en Wallonie, cette technique peut toujours être utilisée. En Flandre, depuis le 1er juillet 2021, cette technique a perdu son attrait fiscal. Vous trouverez plus d’informations sur la page « Léguer à une bonne œuvre ? ».
Exemple 1 : Un testament peut aussi influencer ce qu’il advient de votre héritage après le décès d’un héritier
Pour ce faire, vous devez prévoir dans votre testament une disposition appelée « legs de residuo ». Dans ce cadre, vous désignez deux héritiers. Le premier héritier hérite d’abord de la totalité. S’il vient à décéder, ce qui reste de votre héritage ira au deuxième héritier que vous avez désigné dans votre testament.
Exemple 2 : Pierre et Jeanne sont mariés sans contrat de mariage et n'ont pas d'enfant
Pierre n'a plus ses parents, mais il a deux frères. Jeanne a pour sa part un frère et une sœur. Si rien n'est prévu, au décès de Pierre, Jeanne récoltera la pleine propriété du patrimoine commun et l'usufruit du patrimoine propre de Pierre, en régime de communauté. Mais Pierre veut avantager Jeanne et prévoit un testament qui lui donne droit à la pleine propriété du patrimoine commun et de ses biens propres. Néanmoins, dans ce cas, au décès de Jeanne, c'est la famille de cette dernière qui recevra l'ensemble des biens en ce compris les biens qui lui proviennent de la succession de Pierre.
Si Pierre souhaite que son héritage aille à sa famille après la mort de Jeanne, il peut s’en assurer en déterminant par testament que Jeanne recevra la pleine propriété de la totalité de ses biens mais que, lors du décès de cette dernière, ce sont les deux frères de Pierre qui hériteront de ce qu'il reste du patrimoine de Pierre. De cette manière, les biens de Pierre restent dans sa famille. Au niveau du calcul des droits de succession, ce sont les droits en ligne collatérale qui sont comptabilisés lors du deuxième legs. Cela signifie que les frères de Pierre paieront sur leur part les mêmes droits de succession que s’ils avaient hérité directement de Pierre.
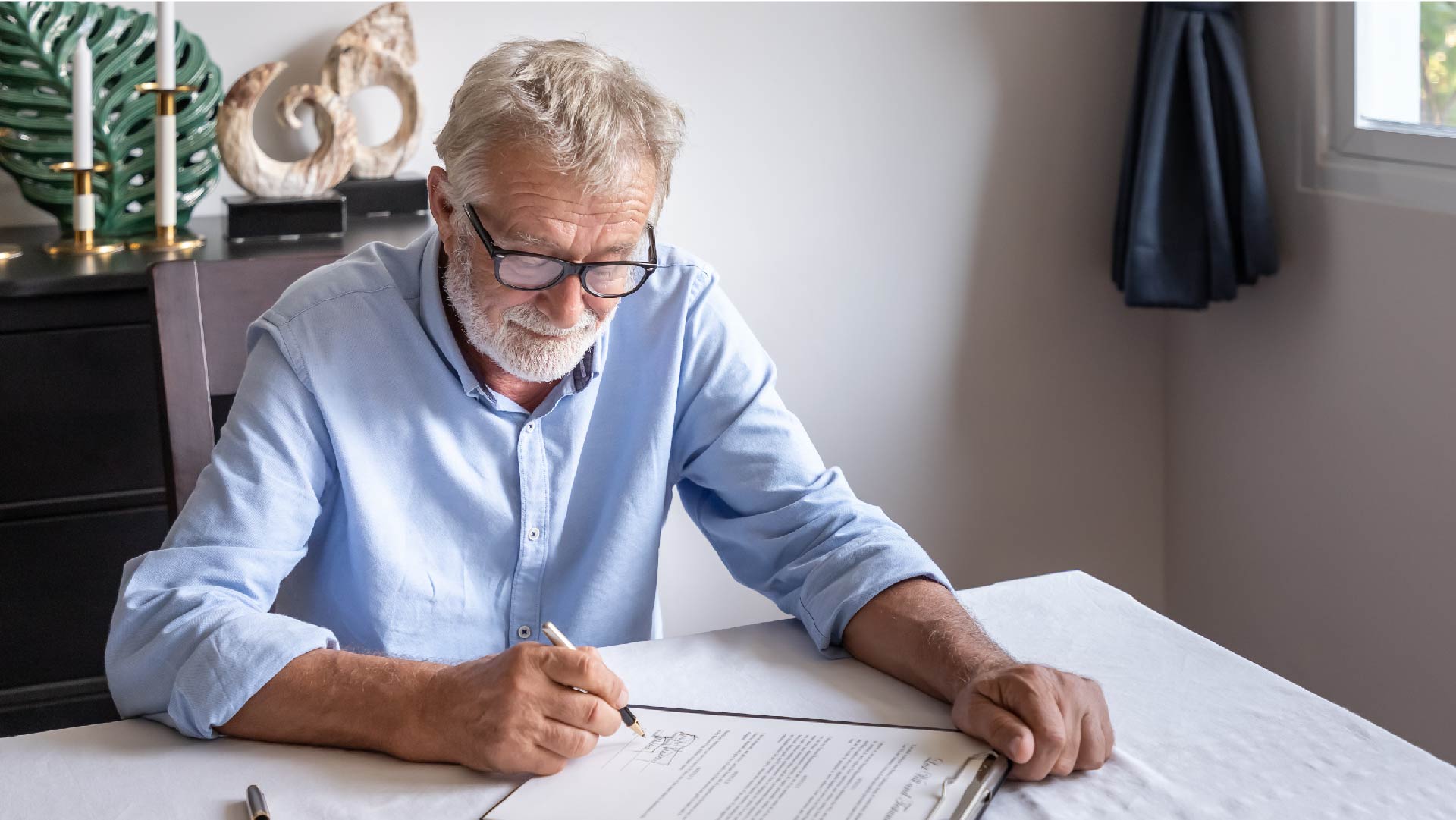
Quelle est l’utilité d’un testament ?
- Le testament peut être utile pour un cohabitant légal ou de fait qui veut octroyer à son partenaire plus de droits que la loi ne le prévoit. Pour rappel : les droits successoraux du cohabitant légal sont limités à l’usufruit du logement familial et de son mobilier. Et le cohabitant de fait ne reçoit même rien dans la succession de son partenaire.
- Un testament permet également d'avantager un ou plusieurs héritiers. Le testament sera donc surtout utile pour décider vous-même de la répartition de votre patrimoine à votre décès.
- Il permet également de prendre des décisions pour d’autres aspects : à qui confier les enfants si vous décédez, quel enterrement vous souhaitez, etc.
- Mais vous pouvez également avoir recours à un testament pour limiter les droits successoraux de vos héritiers. Ainsi, l’usufruit sur l’habitation familiale du partenaire cohabitant légal survivant peut être limité par le biais d’un testament.
Bon à savoir
Vous pouvez régler les dispositions relatives à votre enterrement via un testament.
Attention toutefois, il est préférable d’en informer préalablement les membres de votre famille ou votre commune. En effet, le risque existe qu’un testament ne fasse surface qu’après l’enterrement.
A ce sujet, n’hésitez pas à consulter la brochure « Et après moi ? Instructions à mes proches » de Notaire.be
Comment établir un testament ?
Vous pouvez établir vous-même un testament. C’est ce qu’on appelle un « testament olographe ». Il doit être écrit de votre main, daté et signé.
Cela ne coûte rien à celui qui rédige son propre testament et il peut le modifier sans coût également. Mais si le testament n’est pas rédigé avec précision, il peut donner lieu à des discussions après votre décès. Les héritiers qui se sentent lésés par un testament peuvent prétendre parfois que le défunt n’avait plus la capacité requise pour établir un testament ou que ce n’est pas sa propre écriture. De plus, il faut qu’il soit compatible avec ce qui est légalement possible.
N’oubliez pas aussi qu’après votre décès, votre testament doit faire surface.
Il peut s’avérer utile de confier une copie de votre testament à une personne de confiance (ou pourquoi pas d’en remettre une copie à vos héritiers), mais le mieux est de le faire conserver par un notaire. Il vous suggèrera également de l’inscrire dans le registre central des testaments.
L’autre formule est un testament notarié. Il vous donne davantage de sécurité. Vous devez expliquer vos volontés à un notaire en présence de deux témoins ou d’un second notaire. Le notaire se chargera de traduire vos volontés pour qu’elles soient juridiquement valides. Ensuite, il doit faire enregistrer le testament. Vous êtes ainsi assuré qu’après votre décès, votre testament sera retrouvé et correctement exécuté. De plus, le notaire doit s'assurer que vous êtes en bonne santé au moment de la rédaction du testament. Cela ne peut plus être remis en question par la suite, ce qui rend les testaments notariés pratiquement incontestables.
Mais cette sécurité a un prix : un testament notarié peut coûter quelque 400 euros, et ce coût peut augmenter selon la complexité des dispositions dans le dossier.
Vous avez des biens à l’étranger ou vos héritiers vivent à l’étranger ? Dans ce cas, vous devez en principe aller chez un notaire pour établir un testament.
400 euros
Un testament notarié peut coûter quelque 400 euros.
Souscrire un contrat d’assurance-vie
Si vous voulez planifier votre succession, vous pouvez également envisager de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance-vie. Sous certaines conditions, celles-ci peuvent vous donner le même résultat qu’un testament. Mais elles vont de pair avec des taxes et coûts spécifiques, qui peuvent être importants.
Adressez-vous à votre assureur ou à votre courtier pour obtenir des informations complètes. Et complétez ces informations avec les données que peut éventuellement vous fournir un autre spécialiste, comme par exemple un notaire. Respectez en tout cas cette règle générale : n’achetez pas de produit d’assurance que vous ne comprenez pas.
Plus d’info sur les assurances-vie.
Faire une donation
Plus d’info sur la donation.
Le pacte successoral
Toujours avec la volonté de traiter les héritiers sur un pied d’égalité, la réforme de septembre 2018 a autorisé l’établissement du pacte successoral. Cette manœuvre doit toutefois respecter des conditions strictes, comme la nécessité de passer par un notaire par exemple.
Également appelé pacte successoral global ou familial, il rassemble parents et tous les (petits)-enfants et même les beaux-enfants autour de la table pour compenser certaines inégalités du passé.
L’objectif est d’atteindre un équilibre entre les héritiers, en tenant compte de ce que chacun a reçu en avantages et en donations. Les parents peuvent également tenir compte de la situation personnelle des héritiers.
On part du principe ici qu’il vaut mieux en parler lorsque tout le monde est encore vivant et sain d’esprit, afin d’éviter des désaccords éventuels entre héritiers lors du partage des biens.
Le mandat de protection extrajudiciaire
Plus d’information sur le mandat de protection extrajudiciaire
